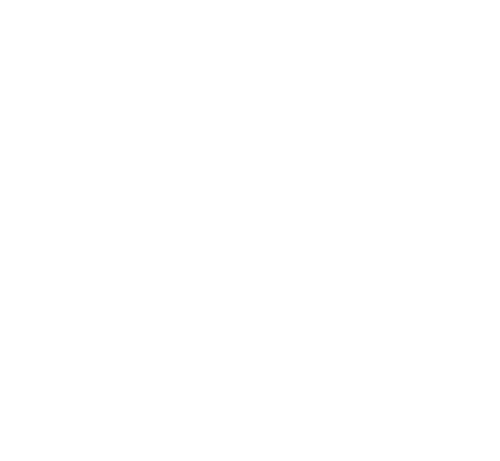En attendant Nadeau - Les scélérats, les brutes et les salauds, par Martine Lebovici

Les scélérats, les brutes et les salauds
Avec Le Procès Eichmann et autres essais, traduit du russe, édité et remarquablement présenté par Luba Jurgenson, les éditions Le Bruit du temps poursuivent leur travail de publication de l’œuvre de Julius Margolin (né à Pinsk en 1900, mort à Tel Aviv en 1971), après Voyage au pays des Ze-ka (2010) et Le livre du retour(2012).
Si le titre met en valeur le cœur du livre – la chronique du procès Eichmann que Margolin publia entre 16 avril et le 17 août 1961 dans le Novoïe Rousskoïe slovo, le journal des exilés russes à New York –, la présence dans le même recueil de textes ayant trait, entre autres, à sa participation comme témoin au procès pour diffamation que David Rousset avait intenté en 1950 au journal Les lettres françaises qui l’accusaient d’avoir inventé les camps soviétiques, permet de comprendre la singularité de son regard sur Eichmann, sur le déroulement du procès de Jérusalem et sa compréhension du nazisme.
Libéré en 1945 de cinq ans de détention dans plusieurs camps soviétiques, Julius Margolin ressent, dès la traversée en bateau qui le ramène en Palestine en 1946, l’urgence de « raconter la vérité que tant d’hommes n’osent, ne veulent, ne savent formuler ou simplement craignent de révéler ». Affrontant les dénégations et les mensonges des communistes occidentaux mais aussi la Realpolitik du jeune État juif, soutenu par l’URSS au début de son existence, il ne renonça jamais à ce devoir. Précisant sa position politique lors du procès de Paris, Margolin remarque qu’il était « sans doute le plus à droite » de tous les témoins, et se définit comme « sioniste et libéral ». Cela ne l’empêcha pas de se sentir humainement proche des témoins plus à gauche que lui, au nom d’un idéal commun de liberté et du même engagement militant « contre la déshumanisation concentrationnaire ». Une déshumanisation spécifique cependant, que Margolin s’efforce de comprendre en lien avec la société soviétique entière dont les camps sont le résultat logique, tout en en concentrant, dévoilant, voire exagérant certains traits caractéristiques. Fort de « l’expertise » qu’il reconnaît à ceux qui ont séjourné tant dans les camps nazis que dans les camps soviétiques, prêt à comparer sans négliger les différences, il est convaincu que « fascisme et communisme » sont « deux variantes d’un régime totalitaire qui nie la liberté et la dignité de la personne ».
Qui est Adolf Eichmann ? Telle est la question ou plutôt l’énigme qui assaille tous ceux qui ont assisté au procès de 1961 (Joseph Kessel, Haïm Gouri, Martha Gellhorn, Harry Mulish, Hannah Arendt…). Pour Margolin l’énigme est celle d’une disproportion entre « cet Eichmann, nullité des nullités, qui ne brillait ni par l’intelligence, ni par la volonté, ni par le talent » et la démesure des crimes commis. Le risque que fait courir une telle disproportion est de nous faire oublier « le petit bonhomme auquel on présente une facture démesurément lourde ». Là est précisément la force du procès Eichmann comme tel : il « est dirigé contre la dépersonnalisation du crime ». On ne juge pas un peuple, une classe ou une idée mais « un homme qui a choisi cette voie en toute liberté ». C’est pourquoi « toute tentative de se présenter comme un petit bureaucrate est vouée à l’échec ».
Margolin le perçoit dès la première apparition d’Eichmann dans la cage de verre : visage émacié, maîtrise de soi, ne tournant jamais la tête vers la salle, « debout, tendu comme une corde de violon, le menton en l’air, les bras le long du corps », il est un « parfait “Obersturmbannführer” ». Silencieux pendant la première partie du procès, on écoute son interrogatoire enregistré par l’officier de police Avner Less, Eichmann prend des notes, fait passer des petits mots à son avocat, comme s’il était « dans son élément », il reste impassible pendant les récits terrifiants des témoins, ne montre jamais aucune émotion. Prenant la parole lors de son interrogatoire par Servatius, il adopte une posture professorale pour tenter d’argumenter son absence de pouvoir de décision et se tient toujours à la stratégie soit de nier son implication soit de se réfugier derrière son obéissance aux ordres.
Des travaux récents sur le procès de Jérusalem ont insisté sur le changement d’attitude d’Eichmann lors du contre-interrogatoire par le procureur Hausner : plus de petit bureaucrate terne et sans personnalité, mais un individu retors, énergique, habile. Margolin qui a assisté à tout le procès le constate aussi : « il se défend becs et ongles », il a une mémoire prodigieuse, il ne renie rien, il assume. Mais pour Margolin cela ne change rien à sa médiocrité, ni ne dévoile des traits qui auraient été invisibles à qui n’aurait assisté qu’à la première partie du procès : Eichmann lui apparaît comme « une poule qui se démène en caquetant sous les attaques d’un épervier ». Au bout du compte : « tout cet interrogatoire est d’un grotesque effroyable » : tout en tenant bon, Eichmann se contredit, s’embrouille pitoyablement. Les justifications qu’il invoque pour se défendre (se présenter comme un bienfaiteur des Juifs qui aurait tout fait pour les sauver, se glorifier de son ingéniosité au moment du plan Madagascar, présenté comme une solution propre à concilier « l’intérêt des deux parties », croire susciter l’admiration en se qualifiant d’« idéaliste », etc.) confirment qu’il est un « être très limité qui ne comprend pas sa situation ».
Quelles que soient ses capacités à ruser, à argumenter, à composer un personnage – aspect sur lesquels insistent certains aujourd’hui en rappelant que l’apparence d’Eichmann n’est qu’une construction faisant partie d’une stratégie de défense –, sa limitation réside surtout dans le fait qu’il n’a aucune notion de ceux à qui il s’adresse : « un homme qui a le passé d’Eichmann aurait pu éviter le pathos moralisant et les propos grandiloquents sur l’honneur et sur son amour exceptionnel de la vérité. Cela suscite le dégoût encore plus que le reste ». Eichmann parle beaucoup mais il « parle pour lui seul ». En d’autres termes, il est incapable de penser du point de vue d’autrui, ce qui va avec la dichotomie qu’il met en place entre la mort de millions de personne résultant de son activité et la représentation de cette activité comme étant criminelle : « aucune vie, aucune mort ne lui semblaient réelles. Même pas la sienne ». C’est pourquoi, selon Margolin, toutes ses justifications – la mention de ses « vertus », son dévouement à Hitler, son « sens du devoir tel qu’il le comprend », son zèle, « se transforment invariablement en leur contraire, c’est-à-dire témoignent contre lui », montrent en permanence qu’il reste un nazi convaincu et non repenti.
Encore faut-il cerner quel type de nazi il est. Il faut pour cela prendre en compte les conditions de l’époque et le niveau auquel poser la question de la responsabilité d’Eichmann : devenu un des acteurs centraux du crime collectif, « personne ne peut le libérer de cette responsabilité, tout comme personne ne peut faire qu’il soit l’unique responsable ». Reprenant une distinction qu’il avait déjà mise en œuvre à propos du régime soviétique, Margolin distingue les scélérats, les brutes et les salauds, en fonction de la distance qu’ils entretiennent avec les victimes. Les scélérats inspirent l’effroi, l’indignation et la haine. Inaccessibles tant pour les victimes que pour la masse de leurs subordonnés, ce sont eux qui conçoivent abstraitement le génocide comme une grande idée nécessaire historiquement mais les détails ne les intéressent pas, c’est aux « sous-fifres » de le mettre en œuvre. À l’autre pôle, en contact direct avec les victimes, il y a les brutes, ces « dizaines de milliers de tueurs et de sadiques qui faisaient le “sale boulot” » et se faisaient photographier avec délectation devant des pendus.
Mais la condition sine qua non du génocide est l’implication de la totalité des institutions civiles et militaires du IIIe Reich. Mobilisées pour la destruction des Juifs, elles comptent sur des hommes comme Eichmann : il est l’instance qui revêt les directives scélérates de chair et de sang avec zèle et enthousiasme. Un ordre ne devient un ordre qu’une fois passé par lui, par sa décision, qui porte à chaque fois sa signature. Il n’est pas un sadique congénital assoiffé de sang. Il est certes antisémite, mais l’antisémitisme n’est pas la clé de l’énigme Eichmann. Pour Margolin, son antisémitisme « est un dérivé de sa possession par la folie totalitaire […]. Dans la Russie soviétique, il aurait été […] un stalinien exemplaire », marchant au pas, c’est-à-dire non seulement un être dépourvu de conscience morale, mais surtout quelqu’un qui a participé à un crime tout en revêtant le masque de porteur d’une « tâche historique ». Le SS est celui qui prête serment à Hitler et se considère lié par un serment, pervertissant l’obéissance à la loi morale kantienne, qui ne délivre jamais l’homme de sa responsabilité, en obéissance au Führer. Pour cela, écrit Margolin, « il n’est pas nécessaire d’être antisémite. Il suffit d’être un salaud. Le reste vient avec ». Ou encore : « un pogrom à l’échelle mondiale organisé par et réalisé par des personnes qui refusent de se dire antisémite, cela donne l’idée de l’ampleur du danger. C’est pire qu’une haine ouverte ». Mais aussi : « il n’existe pas de crime hitlérien dont ne soit capable, dans une variante parallèle, un stalinien fanatique ».
Ce recueil d’articles politiques de Julius Margolin nous arrive d’une autre époque, celle d’avant la chute du mur de Berlin. Son point de vue, énoncé d’une façon qui paraîtra abrupte à certains lecteurs, est résolument anti-totalitaire, ce qui rend son compte rendu du procès Eichmann si singulier. Sans que sa chronique recoupe toutes les positions d’Eichmann à Jérusalem (Margolin fait l’éloge du procureur Hausner, apprécie différemment l’importance accordée aux témoignages, ne s’attarde pas sur les aspects proprement juridiques du procès, etc.), elle entre très souvent en résonance avec l’ouvrage à nouveau si controversé d’Hannah Arendt et lui apporte peut-être un soutien inattendu.
Martine Lebovici