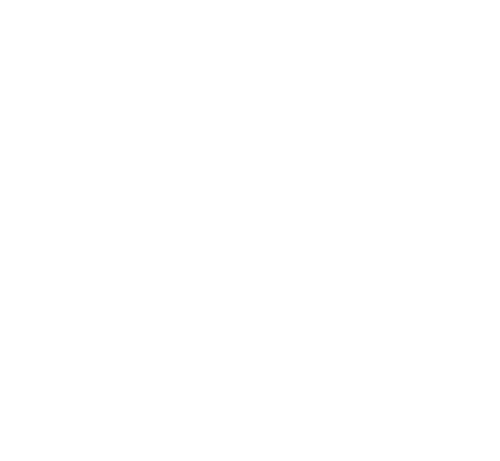Le Matricule des Anges - Les ambulations gratifiantes, par Éric Dussert

Les ambulations gratifiantes
Double parution pour un Gilles Ortlieb désormais consacré : de nouveaux itinéraires et des hommages littéraires renouvelés.
Depuis la publication des contes grecs de L’Arbre-serpent (Bordas, 1982), Gilles Ortlieb mène une double activité de traducteur et d’écrivain itinérant. Né en 1953 à Ksar el-Souk au Maroc, il chemine assez pour perpétuer la tradition d’Apollonios de Tyane, le philosophe errant. Les seuls titres de ses vingt-quatre livres portent mention des toponymes de Luxembourg, Gibraltar, Moyeuvre, Bruxelles ou de la Meuse, témoignant parfaitement du soin qu’il prend grâce à sa profession d’interprète de parcourir l’Europe, si ce n’est le monde, à la recherche de... Mais que recherche-t-il donc ?
À travers les catalogues des maisons Obsidiane, Gallimard, Théodore Balmoral ou Finitude puis Le Bruit du temps à partir de 2014 et la réédition de Soldats et autres récits, Gilles Ortlieb semble avoir maintenu un programme « Search and describe » : chercher et décrire l’œuvre de ses pairs dans le recueil augmenté des articles rédigés Dans les marges des livres chers à son cœur, et, dans le recueil de ses « départs », chercher et décrire ces moments où son regard se pose sur les paysages qui l’accueillent et lui fournissent la surprise, le songe, la réflexion, l’amusement Et tout le tremblement, ce qui met la littérature en marche. Sur les « sentiers insoupçonnables » de Porto à Zante (île ionienne) en passant par Naples et Zante (Lettonie), il y prend acte des beautés et mystères que lui offre le monde.
Qu’est-ce qui a changé depuis le dossier du Matricule des angesqui vous était consacré en 2004 ?
Je ne suis sûrement pas le mieux placé pour répondre à cette question. Qui pose, indirectement, celle du « progrès » en littérature, non ? Mais, de même qu’on ne part pas, je ne crois pas qu’on change beaucoup... On a beau rajouter des teintes sur la palette, je soupçonne que les rapports chromatiques n’évoluent guère. Je m’étais interrogé là-dessus dans une préface à la réédition de Soldats et autres récits : et la conclusion avait été, entre autres, que l’on peut s’imaginer avoir identifié des pierres de touche, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’on saura les transformer en pierres à aiguiser. De notable (à mes yeux, s’entend) depuis le dossier dont vous parlez, il y aura eu un travail in situ sur le séjour calamiteux de Baudelaire en Belgique, quelques écrits sur des écrivains méconnus, ou sur l’un ou l’autre versant méconnu d’écrivains connus, ou encore le récit de virées dans la Lorraine profonde, sur les traces d’une Lorraine sinistrée, vitrifiée. Autant de mouvements vers le dehors ou vers d’autres choses que le petit théâtre intime, même s’ils renvoyaient finalement au dedans auquel on voulait ou croyait échapper. En bref, il s’agissait de débrider un peu le rapport au monde, d’aller « y » voir de plus près ou plus en détail, quitte à ce que d’autres attaches ou entraves se fassent sentir en chemin. La partie n’est donc pas gagnée. Et puis il y a eu dans le même temps, par une sorte de mouvement inverse, de la périphérie vers le centre donc, la main courante, les notes au jour le jour de trois petits volumes parus chez Finitude, censés aider à y voir plus clair : le fragment érigé en mode de perception, en somme. Avec les limitations du genre, et qu’on sait.
Parmi ces fragments, on trouve les notes du lecteur Ortlieb qui s’attache à promouvoir les œuvres de Jean-Luc Sarré, d’Odilon-Jean Périer ou de Kostas Karyotakis. Y trouve-t-il de quoi décrire celui qu’il est, comme l’ont tenté Montaigne, Leiris ou Jacques Borel ?
Laissons peut-être de côté les trois noms que vous citez – pour des raisons d’échelle évidentes... Mais il est sûr que certains choix sont téléguidés (pas si télé- que ça, d’ailleurs, dans la mesure où les auteurs en question ont forcément touché au plus près), et que leur assemblage finit par délimiter un espace concave, par dessiner une sorte de portrait en creux, je suppose. Dont les traits se déduisent par défaut, de ce qui est laissé à entendre ou suggéré en passant. Quant à savoir précisément ce qui nous touche chez eux, si on pouvait le nommer avec la même précision, on cesserait peut-être du même coup de le rechercher chez autrui, à tâtons pour ainsi dire ? On touche là à la question de la langue et du style, où ce qui est passé sous silence, comme on dit, compte au moins autant, voire plus, que ce qui est donné à lire, et filtre l’expression en amont, de façon plus ou moins consciente.
Pour avancer sur la voie de la langue et du style, faut-il se « retrouver sans attaches ni obligations dans une ville à peu près inconnue » ?
Non, bien sûr, mais le fait de devoir appréhender une réalité nouvelle, mal connue, amène souvent à remarquer des choses qui, dans un environnement familier, passeraient inaperçues. Virginité serait un grand mot, mais disons une « remise à zéro » du regard ? Il s’agit là de réactions d’ordre chimique, du type acide-base, ou même de lois purement physiques : « Tout corps (et tout esprit ?) plongé dans un environnement étranger finit par etc. » L’appropriation peut passer par là, par les mots, ce sera même souvent le moyen le plus « économique ». Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’on écrira mieux, évidemment. Mais cela peut amener à s’engager sur des sentiers insoupçonnables à l’avance.
Comment, au fil du temps, le métier et l’art d’écrire s’apprennent-il encore ?
En allant chercher du côté où l’on n’est pas, a priori, attendu. Il y a des situations ou conjonctures dont on sait par expérience qu’elles resteront muettes ou déclencheront quelque chose, selon. Et puis d’autres qui restent ouvertes, qui peuvent basculer d’un côté ou de l’autre. Il y a en général des enseignements à tirer de ces oscillations. Cela peut paraître contradictoire avec la réponse à votre première question, mais il y a plusieurs sortes de déplacements, faut croire. Dans l’espace, ce qui en représente la forme la plus accessible, et avec les réactions qu’on peut en attendre. Et puis ceux qu’on effectue à des profondeurs variables, dont on a peut-être le plus à apprendre ? Peut-être que, en combinant les deux... ?
Les injonctions de l’œil capté par les décorations du monde (signalétiques, collections de musées, paysages, etc.) se résolvent-elles toujours en écrit ?
À défaut de les résoudre, on peut au moins essayer de les désamorcer par écrit. Je me souviens d’une virée du côté de Verdun, il y a quelques années, et de certains toponymes relevés sur place ou sur des cartes de la région : Froideterre, La Potence, Le Mort-Homme, La Folie, La Vermine, Bois des Malades, Ravin de la Gueule-aux-Chevaux... On ne neutralise rien en l’écrivant, mais on aura au moins pris acte, sans glisser seulement sur la surface des choses, comme on le fait neuf fois sur dix. L’onomastique en vient ainsi à jouer un rôle parfois disproportionné, dans le rapport ambulant avec un lieu. Que ce soit à Marseille, où on peut tomber sur une rue des Nébuleuses, une avenue du Point d’Interrogation ou une impasse Quo Vadis, à Bruxelles (rue d’Une-Personne, rue du Souvenir, rue du Taciturne...) ou à Lisbonne (Travesa dos remedios, Largo do Socorro, rua da Leva da Morte...), il est évidemment très tentant de voir dans ces appellations des messages, des clins d’œil, voire des résumés-de-la-situation. De même, pour les paysages qu’on voit défiler depuis la fenêtre d’un train, par exemple, lorsqu’on a une première fois assimilé la vision d’un champ de colza à quelque chose comme une gifle jaune, les fois suivantes deviennent moins violentes. Idem, enfin, pour les enseignes, qui sont parfois les seules inscriptions éclairées, de nuit, et s’impriment d’autant plus facilement pour cette raison même, ou qui acquièrent des résonances particulières lorsqu’elles sont à moitié effacées, en faisant s’entrechoquer présent et passé. Je me souviens d’une que j’avais vue à Bruxelles, au-dessus d’une vitrine : Palais du Pantalon. Trois lettres étaient tombées du premier mot, ne restait plus que le P l i du pantalon. C’est le genre de gratification réservée aux promeneurs quand ils ne les cherchent pas.
L’observation du monde aide-t-elle à devenir celui que l’on a décrit ?
L’observation du monde, quand on s’y adonne au point de percevoir – ou de croire percevoir – certaines choses par transparence, c’est tout à la fois une rampe, un miroir ambulant et un champ d’expérimentation. Par cumul, une observation horizontale ou étirée dans le temps peut déboucher sur des intuitions ou aperçus « verticaux », je veux dire sur des évidences qui s’imposent avec autant de force que si elles étaient immédiates. Elle réserve aussi des surprises, avec des réponses qui surviennent parfois là où on ne les attendait pas. Cela aide, évidemment, non pas tant à devenir celui que l’on décrit, qu’à débrouiller ce qui nous entoure, à le rendre plus lisible.
Avez-vous finalement découvert « La Beauté » ?
Les seins d’Artémis, entrevus dans un musée de la banlieue d’Athènes, n’en étaient pas très éloignés. De même que les osselets brunis rassemblés sous une vitrine, quelques mètres plus loin, et avec lesquels des petits Grecs d’avant Jésus-Christ avaient donc joué à la petite ou à la grande balayette, en se disputant sans doute comme des écoliers marchandant des cartes de Pokémon dans une cour de récré. Mais elle peut aussi bien se loger dans un lot d’huiles sur papier peintes à Naples, dans un quasi-anonymat, par un artiste gallois, puis découvertes un siècle et demi plus tard, en même temps que ses mémoires. Ou même, pour peu que les circonstances s’y prêtent, dans la végétation des bords de voie d’une petite gare du réseau ferré secondaire, voire dans une devanture d’épicerie de quartier, avec les carrés de couleur des fruits et légumes éclairés par une ampoule nue – les exemples ne manquent pas.
Quelles sont les prochaines stations de l’observateur Ortlieb ?
Il y a un projet, pour lequel je me suis déjà rendu plusieurs fois au Portugal, autour de la figure d’une sorte de Robert Walser local (en moins prolifique) que Fernando Pessoa avait publié dans sa revue Orpheu, et qui aura passé, après des tribulations diverses, les vingt dernières années de sa vie dans un hôpital psychiatrique à Lisbonne. J’ai pu recueillir des témoignages, ai pas mal rôdé sur les lieux, j’ai même trouvé, chez un bouquiniste de Porto, des documents et manuscrits inédits, bref la matière première est à peu près rassemblée, reste maintenant à trouver une forme appropriée, à ne pas s’égarer dans des lectures connexes, à garder ses distances avec quelques fantômes, autrement dit à ne pas nager en rond dans le petit lac qu’on s’est creusé. On verra bien. Et pour le reste, le tout-venant, le quotidien, aussi – même s’il y a parfois des raisons de se demander si on ne serait pas à la fois le garde et la chiourme ? Faire avec.
Propos recueillis par Éric Dussert
n° 174