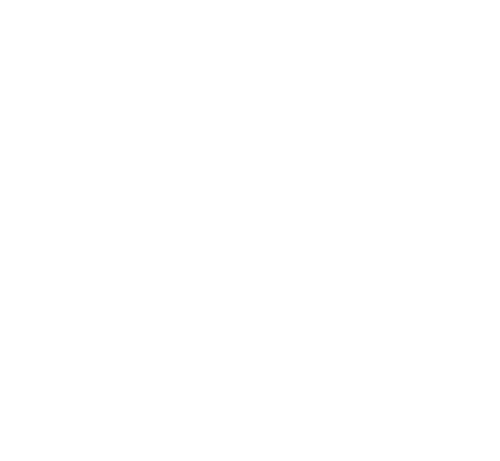Le Monde : « Perdu à jamais », de Theodor Fontane : fin d’un mariage, fin d’un monde

Nouvelle traduction d’un classique allemand du XIXᵉ siècle, qui renvoie étonnamment à nos désillusions contemporaines.
Parce qu’il est coincé entre un géant comme Goethe et d’autres auteurs immenses de la littérature allemande au XXᵉ siècle, comme Thomas Mann ou Günter Grass, qu’il a pourtant inspirés, l’écrivain Theodor Fontane (1819-1898) peine à se faire connaître en France pour ce qu’il est outre-Rhin et ailleurs : un classique de la littérature européenne et germanophone. Fontane est également, avec le suisse Gottfried Keller (1819-1890), l’un des représentants éminents de l’école réaliste, qui, dans la période d’après les révolutions allemandes de mars 1848 (Nachmärz), se caractérise – comme en France le naturalisme d’Emile Zola, auquel Fontane fut parfois comparé – par une ambiance de désillusions. Comme si, après les enthousiasmes des Lumières, le progrès commençait à faire voir ses premiers effets pervers, et la société bourgeoise, des signes de décomposition.
Perdu à jamais (1892), qui paraît dans une nouvelle traduction (le roman avait déjà été traduit par Jacques Peyraube sous le titre de Jours disparus, éd. Robert Laffont, « Bouquins », 1981), est également l’histoire d’une désillusion, celle du mariage. Dans la situation confuse qui précède la guerre des Duchés – elle opposa le Danemark à la Prusse de Bismarck en 1864, cette dernière finissant par l’emporter et par annexer le Schleswig-Holstein au futur empire –, un couple d’aristocrates se délite imperceptiblement sans percevoir les signes annonciateurs de la fin de leur monde. Les événements historiques servent ainsi chez Fontane, qui a exercé sa plume comme journaliste et chroniqueur des conflits du XIXᵉ siècle, de fonds de tableau à l’intrigue. Le comte Holk et la comtesse Christine font l’épreuve, dans ce contexte, d’une incompatibilité croissante d’humeur et de caractère qui va provoquer entre eux une crise fatale.
Coups de boutoir
Christine est proche d’un courant protestant piétiste, celui des frères moraves. La religiosité de cette femme de principe et dévote finit par exaspérer son époux, qui affirmera préférer « l’harmonie à l’harmonium ». Holk en vient à quitter les austères rivages du nord de l’Allemagne pour Copenhague, où le goût des plaisirs amène ce hobereau féru de généalogie et de convenances sur la voie d’un adultère irréparable. On voit bien que, dès cette époque, l’institution du mariage, symbole de stabilité, commence à subir quelques coups de boutoir. Cette dégradation est décrite, tout en finesse, par les petites piques que s’envoient les protagonistes, dans un récit toujours porté par la conversation mondaine, ou par les lettres que s’envoient les personnages. Contrairement à Zola, les scènes scabreuses ne sont évoquées que par allusion, laissant au lecteur le soin de deviner ce qui se passe dans les alcôves, sans y entrer jamais.
C’est dans la chambre d’Ebba (Eve) von Rosenberg, la dame de compagnie de la princesse danoise dont Holk est le chambellan, que va sombrer le mariage. Une figure troublante à bien des égards que cette Ebba. Demi-juive et demi-suédoise, elle rassemble certains stéréotypes antisémites d’époque. Effrontée, poussant au vice, qualifiée de « diablesse », avide d’argent, elle entre dans le mythe de la « belle juive » corruptrice de l’ordre social, incarné par Holk et Christine. On sait que la volumineuse correspondance de Fontane est parsemée de préjugés antijuifs, particulièrement aigus dans la décennie 1890. On en croyait l’œuvre immune. Perdu à jamais montre que tel n’est pas le cas.
Toutefois, même si ce thème n’est pas marginal, on ne saurait y réduire le roman, pas plus qu’il ne serait juste d’y voir seulement un défilé rétro de crinolines et de huit-reflets. A bien des égards, derrière le conformisme guindé des personnages, Fontane décrit une société qui n’est pas sans rapport avec la nôtre. Les femmes n’y acceptent pas leur sort avec soumission, ne se privent pas de se jouer des hommes comme Ebba, ni, comme Christine, de décevoir brutalement les espérances de réconciliation d’un époux fautif trop pressé de rentrer au bercail et de récupérer une façade respectable après une séparation ratée. La sexualité affleure et n’en est que plus présente, tout comme le désir exprimé par Holk de vivre dans une « création qui n’est pas le paradis mais qui en est un reflet (…) plutôt que de regarder un aigle royal ou même un condor monter solennellement vers le ciel ». S’il serait exagéré de considérer Perdu à jamais comme un roman de « sortie du religieux », on y perçoit un appel à vivre autrement qui se laisse volontiers entendre.
Extrait
« Holk s’arrêtait de temps en temps pour regarder vers Holkenäs. Le château s’offrait clairement à sa vue, maintenant que le brouillard s’était momentanément levé, mais désert et solitaire, et la mince fumée qui s’en dégageait donnait l’impression d’une demi-vie seulement. Les buissons assez nombreux devant la façade du vestibule étaient tous dénudés, sans feuilles, à l’exception de deux petits cyprès, et le vestibule était lui-même clôturé de planches et de tapis pour protéger autant que possible de la bise les pièces auxquelles il donnait accès. Tout était silencieux et mélancolique, non sans qu’une paix comme le reflet d’un bonheur d’autrefois n’y règne, et c’était cette paix qu’il venait perturber. »
Par Nicolas Weill