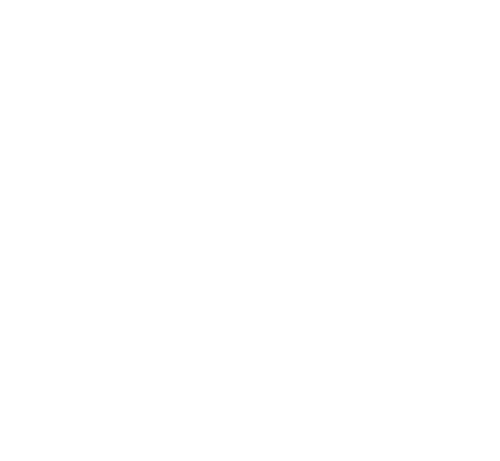Le Temps - Un Européen au Goulag

Un Européen au Goulag
Julius Margolin est sorti en 1945 du Goulag. Interné pour rien, il écrit immédiatement l’un des premiers et des plus vibrants témoignages sur les camps soviétiques. Son récit est réédité intégralement.
«Lecteur, n’excuse pas les camps soviétiques parce qu’Auschwitz, Majdanek et Treblinka furent pires. Rappelle-toi que les usines de mort de Hitler n’existent plus [...]. Mais le 48e Carré, Krouglitsa et Kotlas fonctionnent toujours, et des hommes y périssent aujourd’hui comme ils y périssaient il y a cinq et dix ans.» Ainsi témoigne, en 1949, un homme au physique doux, aux petites lunettes rondes, mais à la voix ferme et résolue: Julius Margolin, qui sort de cinq ans d’enfer dans les camps soviétiques. Pour rien. Il est l’un des premiers à révéler leur existence et il œuvre à la libération des millions de zeks qui y croupissent encore pour des crimes inexistants.
Mais l’Europe, qui se relève du nazisme, reste en grande partie sourde à son appel. Les témoignages sur les camps de la mort allemands affluent – au premier chef, celui de Primo Levi, Si c’est un homme, d’une puissance d’évocation inégalée –, monopolisent l’attention, suscitent un unanime – et légitime – recueillement. Mais les bagnes soviétiques font l’objet d’une polémique extrêmement dure entre les intellectuels communistes (ainsi que ceux qui jugent prudent de ne pas inquiéter le puissant «Petit Père des peuples») et les anticommunistes ainsi que des voix indépendantes. Nombre d’intellectuels français séduits par l’URSS refusent purement et simplement de croire aux «camps de rééducation».
Margolin trouve tout de même des alliés: Nina Berberova traduit son récit, qui paraît en partie chez Calmann-Lévy sous le titre de La Condition inhumaine en 1949, suivie par une édition russe de l’émigration. Arthur Koestler tente d’attirer l’attention des intellectuels américains sur son témoignage. La New York Review of Books et Le Figaro en publient des extraits. Enfin, l’écrivain français David Rousset l’invite en 1950 à témoigner au procès qu’il intente contre Les Lettres françaises. La revue, proche du PCF, avait traité Rousset de «falsificateur trotskiste» suite à son initiative d’instaurer une commission d’enquête sur les exactions et les camps dans les régimes totalitaires, notamment soviétiques.
À la barre, face au rédacteur en chef Pierre Daix, chantre du stalinisme et ancien déporté à Buchenwald, Margolin produit un puissant réquisitoire contre l’esclavage soviétique, à ses yeux inhérent au communisme. On l’accuse de faire de la propagande. Margolin l’admet volontiers dans son livre: oui, son témoignage est de la propagande, mais «dans la mesure où La Case de l’oncle Tom de Harriet Beecher-Stowe fut de la «propagande» contre les Etats esclavagistes du Sud».
Ainsi reparaît aujourd’hui au Bruit du temps – jeune maison d’édition qui se consacre aux chefs-d'œuvre oubliés (Le Temps du 04.08.2009) – et dans son intégralité ce magnifique texte longtemps ignoré, pour le malheur de son auteur qui, jusqu’à sa mort en 1971 à Tel-Aviv, n’aura cessé de secouer l’opinion pour tenter de faire libérer les zeks et plus tard favoriser l’émigration des Juifs d’URSS en Israël.
La spécificité de ce récit, qui s’inscrit dans une très vaste littérature sur les camps soviétiques, est le point de vue de l’auteur: contrairement à Varlam Chalamov ou Alexandre Soljenitsyne, Margolin n’est russe que de langue maternelle. Il n’a pas connu la lente descente aux enfers de la terreur stalinenne dans les années 1930. Ainsi, les lageri du NKVD apparaissent comme une terrible surprise à cet Européen, docteur en philosophie, profondément démocrate.
Qu’est-ce qui lui vaut sa déportation? La malchance d’être Juif polonais et de se trouver au mauvais endroit. Né russe sous le tsarisme, puis citoyen polonais après la Première Guerre mondiale, il émigre en Palestine britannique à la fin des années 1930. Or, en 1939, Margolin se trouve à Lód! en Pologne pour son travail. Par bonheur, il a laissé femme et enfant à Tel-Aviv.
Quand la guerre éclate, il tente de fuir mais se retrouve coincé entre la Wehrmacht et l’Armée rouge. Dans Pinsk occupée par cette dernière, les Soviétiques font une offre funeste aux Juifs : accepter le passeport soviétique ou être «transféré» du côté allemand. Certains choisiront l’Allemagne, horrifiés par la soviétisation au pas de charge de la région. Margolin ne choisit pas. On l’arrête et le condamne à 5 ans de camp. Une paille pour les Russes, relate-t-il, pour qui le minimum est 10 ans.
D’abord, il est convaincu qu’il est l’objet d’une méprise et invoque sa carte de résident palestinien. Puis il va comprendre: tout est truqué, l’apparente légalité repose sur un mensonge. Il ne sait pas que la déportation de centaines de milliers de Polonais et de Juifs repose sur un plan de nettoyage ethnique et d’un besoin de main-d’œuvre à l’échelle de la démesure.
Deux tiers du témoignage évoquent la vie au camp, d’une effrayante monotonie. Dix à douze heures par jour dans la forêt à couper du bois, habillé de guenilles – il parvient à être de temps à autre employé comme secrétaire. Une ration de kacha calculée selon l’effort fourni, de toute façon insuffisante, dégradant l’organisme, condamnant les plus faibles à mourir d’épuisement. La nuit, les ourki, les droit commun mélangés aux politiques, pénètrent dans les dortoirs, s’emparent des reliques sacrées des zeks: une montre, des lunettes (vitales pour Margolin), un petit oreiller brodé...
On ne vole pas que les objets. On traque les pensées, qu’il faut enfouir en soi très profondément. Et puis, il faut endurer les soirées idéologiques, les vaines attentes devant l’infirmerie, la corruption extrême et la brutalité des chefs de camp. Margolin enregistre tout. Et en premier lieu, le processus de déshumanisation et la névrose qui ronge le zek: «Dans les camps allemands, on tuait la fille sous les yeux de la mère, et la mère s’éloignait en souriant d’un sourire de folle. Dans les camps soviétiques, on ne connaît pas ses horreurs, mais eux-mêmes ne sont qu’horreur, par leur importance, leur structure solide et le pouvoir de l’Etat. Les hommes qui y vivent semblent normaux; mais à l’intérieur, ils ne sont que plaie ouverte. S’ils pouvaient pleurer ou protester, ils seraient encore normaux.»
Voilà la force de son récit : l’œil étonné, mais toujours plus aguerri du bagnard nous permet de ressentir un enfer gris, peuplé de loqueteux apathiques. Le mal n’est pas incarné: c’est un agent corrosif invisible qui détruit le corps et la raison.
Lui-même, issu de la fine fleur intellectuelle d’Europe centrale, en vient à rouer de coups – pour la première fois de sa vie – un voisin qui fouillait dans ses affaires. Il raconte comment la faim, permanente, empêche de penser, détruit la libido. Son impressionnante mémoire enfin restitue les destins de dizaines de compagnons, les amitiés trop vite rompues par les multiples transferts, Aliocha, les cinq Isaac et tant d’autres.
Comment tient-il? Il n’est pas vraiment croyant, et pas assez simple, comme Ivan Denissovitch, pour accepter l’iniquité sans se révolter. Mais, en sioniste convaincu, il croit à l’esprit de communauté, au travail collectif fondé sur l’enthousiasme, au projet juif en Palestine. Fondé sur un sinistre mensonge et le mépris de la vie humaine, le 48e Carré, Krouglista et Kotlas en sont la prise de vue en négatif. L’optimisme contagieux de Margolin penche pour un avenir de clarté.
Aujourd’hui, les camps ne sont plus, du moins dans cette région du monde, mais l’oubli a pris le pas sur le déni. Il n’est nul besoin de dresser le mémorial des crimes nazis contre celui des soviétiques, de compter les morts ou le degré d’horreur. Mais relire ce long et très prenant récit de la maison des morts, bas-fonds d’un système dirigiste, que plusieurs générations d’intellectuels ont sanctifié au nom du paradis terrestre à venir et de la marche de l’histoire, constitue aussi un antidote aux nouvelles tentations totalitaires.
Emmanuel Gehrig