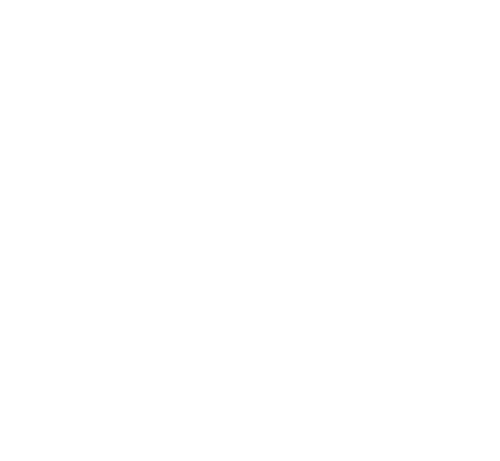Libération : Georges Séféris, label hellène, par Frédérique Fanchette

En 1939, Henry Miller est à Athènes, l’écrivain américain rencontre Georges Séfériadès, diplomate, poète et futur Prix Nobel. Dans le Colosse de Maroussi, livre qui retrace cette année en Grèce, il écrit : «L’homme qui a saisi cet esprit d’éternité que l’on trouve partout en Grèce, l’homme qui l’a fixé dans ses poèmes, c’est Georges Séfériadès, dont le pseudonyme littéraire est Séféris […] Séfériadès est le plus asiatique des Grecs que j’ai rencontrés. Il est originaire de Smyrne, mais il a longtemps vécu à l’étranger. Il est langoureux, suave, plein de vitalité, capable d’exploits surprenants de force et d’agilité.» Puis Miller raconte la visite d’un lopin de terre avec le poète, désireux de construire un bungalow. Le lieu lui paraît à première vue plutôt «miteux et abandonné». Mais la magie Séféris se met à l’œuvre : « Je vis l’endroit se métamorphoser sous mes yeux, pendant que Séfériadès m’entraînait, comme une méduse électrisée, de place en place, mêlant dans une même rhapsodie herbes, fleurs, buissons, rocs, argile, pentes, déclivités, criques, goulets et le reste. Tout ce qu’il regardait était grec à un point qui lui était resté inconnu tout le temps qu’il n’avait pas quitté son pays. Il regardait un promontoire, et il y lisait l’histoire des Mèdes, des Perses, des Doriens, des Crétois, des Atlantes. […] Le poète universel commençait à mûrir en lui, à force de s’enraciner passionnément dans le sol de son peuple. »
Le journal de Séféris commencé en 1925 à quelques jours de ses 25 ans, et qu’il poursuivra jusqu’à la fin de sa vie, mentionne lui aussi le Miller de 1939. Ils vont dans des tavernes, passent du temps avec l’ami Katsimbalis, de colosse de Maroussi», serendent ici ou là, comme ce mercredi 29 novembre: «Après-midi à Rafina, avec Henry Miller. Temps couvert, une mer d’huile. Les bruyères, la terre rouge. Les montagnes de l’Eubée, Couleurs. Mais un serrement de cœur devant les constructions nouvelles. » Est-ce l’endroit dont parle l’Américain dans son livre ? En tout cas le contraste entre les deux ouvrages est violent. Avec Miller, le temps est réduit à l’instant, à sa célébration. Dans cette Grèce encore neutre, on n’entend presque aucun écho des débuts de la Seconde Guerre mondiale. Le journal de Séféris au contraire, et c’est ce qui le rend précieux, mêle l’intime, l’introspection aune chronique des faits nationaux et internationaux. Avec lui, les événements sont enchâssés dans le récit de la vie au quotidien. L’incrédulité, le dégoût devant l’esprit munichois, la peur se font percevoir de façon encore plus sensible. Dix-sept mois plus tard, Séféris va partir, l’un de ses innombrables exils. Les Allemands envahissent la Grèce en avril 1941.
« QU’ÉTAIT DEVENU L’OURSIN ? »
Deux scènes au long de ces 800 pages titrées Journées. 1926-1944 sont jumelles. Elles disent tout de l’attachement du poète à sa terre, la douleur de l’éloignement (« Où que me porte mon voyage, la Grèce me fait mal », écrit-il dans un poème de 1936). La première ouvre ce journal, la seconde le clôt presque. Après plusieurs années en France et en Angleterre, en 1925, le jeune homme rentre en bateau. «A sept heures du matin, le Pierre Lori a accosté au Pirée : la Grèce. En juillet dernier, cela aura fait six années d’exil à l’étranger sans interruption. Ma mère m’attendait sur le môle [...]. La Grèce ; l’épreuve inévitable. Il ne pouvait en aller autrement, ce n’est que justice. » En octobre 1944, l’écrivain retrouve une nouvelle fois son pays, après l’éloignement dû à la guerre. Une tragédie mondiale s’est entretemps déroulée, Séféris a forgé sa langue de poète. Letexte daté du dimanche 22 octobre est saisissant : « Quand on entre en Grèce, on a le sentiment, non pas d’avancer, mais de gravir des marches, de passer un seuil. C’est un autre monde, qui se situe à un autre niveau. Ce matin, la pointe orientale d’Hydra, Poros, et puis la montagne d’Egine, épine dressée derrière le promontoire, et ensuite, dans les jumelles, l’Acropole. J’ai été, je crois, le premier à l’apercevoir. Tout le monde à bord, les étrangers comme les Grecs, soldats et gradés, tout l’équipage du bateau, de la proue à la poupe, s’était figé dans un silence absolu, comme lorsque le chef d’orchestre frappe le pupitre de sa baguette dans une salle de concert. Aujourd’hui, cela fait exactement trois années et demie que j’ai quitté le Pirée, le 22 avril 1941. « C’est la plus belle journée du monde, la plus légère.» Les semaines qui suivent contredisent ce moment de grâce. Le quartier où vit le poète à Athènes est au cœur de violences, prélude à la guerre civile à venir. Des cadavres gisent en pleine rue. Le livre se termine avec la nomination par le roi d’un régent, monseigneur Damas-Kinos, dont Séféris devient le chef de cabinet. Une autre époque s’ouvre qui le verra comme toujours tiraillé entre ses deux métiers: l’écriture et les affaires publiques.
Le journal de Georges Séféris représente au total neuf volumes. Journées. 1925-1944 correspond aux quatre premiers tomes. Un choix de pages traduites et présentées par Denis Kohler était paru en 1988. Mais c’est la première fois que le journal de cette période est traduit en intégralité en France. À côté de l’œuvre poétique, le travail de diariste fournit au lecteur français un point de vue excentré sur la Seconde Guerre mondiale. La menace italienne, le machiavélisme des Allemands attachés un premier temps à la neutralité grecque, le non de l’autocrate grec Metaxas à Mussolini, la résistance désespérée des Crétois... Le haut fonctionnaire Séféris, aux premières loges, analyse la géopolitique des Balkans. Avec toujours, en arrière-plan, une question : que représente l’espace spirituel de l’hellénisme dans ces années sombres ?Dès l’adolescence, le futur poète se voit arraché à sa terre. Issu d’une famille de Smyme, dans une Asie mineure habitée par les Grecs depuis 3000 ans, il quitte sonparadis d’enfance en 1914. Huit ans avant «la Grande Catastrophe», l’expulsion assortie de meurtres des Grecs de Smyrne et de l’Ionie. Le père, professeur de droit, conscient des dangers du nationalisme ture, embarque toute la famille pour Athènes, puis la France. Séféris étudie à la Sorbonne, se prend de passion pour Jules Laforgue et Paul Valéry. Mais il écrit en grec. Les lettrés de son pays sont divisés entre les puristes attachés à un état de la langue fixé des siècles auparavant, Le jeune poète, lui, défend avec d’autres le grec moderne démotique, qui ne méprise pas le parler de la rue, une langue en cours de création.
Pendant les vingt années de ces Journées, Georges Séféris est le plus souvent hors de Grèce. L’Angleterre d’abord, puis le fin fond de l’Albanie – il est en disgrâce. Plus tard, c’est l’Afrique du Sud, l’Egypte. L’ennui du travail consulaire favorise l’écriture poétique. Lui qui dit « être rien sans la matière de [son] pays » s’avère finalement très productif. En 1932, à Londres, il a froid, est malheureux et loin de La femme aimée, Loukia. Cela se reproduira en Albanie, avec cette fois la souffrance d’être séparé de Maro, épousée ensuite. Pour Loukia, il écrit le recueil la Citerne et note à la date du 23 avril 1932 : « Il y a des gens qui “considèrent” que les poètes ont de l’imagination, c’est-à-dire l’équivalent d’un nuage bondissant au-dessus d’un autre nuage. En vérité, les poètes reproduisent la vie de beaucoup plus près que les autres ne la voient. De si près, même, que l’objet reproduit (sur le motif) se résorbe. C’est peut-être la raison pour laquelle les autres ne comprennent pas. J’ai une fois observé au microscope un piquant d’oursin, en coupe. Gela ressemblait à une broderie savante et virtuose, de la taille d’une pièce de cinq drachmes – qu’était devenu l’oursin ? »
PLUS OBSERVATEUR QU’HOMME D’ACTION
Le lien avec Londres semblait moins fort que celui avec Paris, ville de sa jeunesse étudiante, Mais le tropisme anglais domine, avec notamment l’amitié pour Lawrence Durrell, en Grèce, en Egypte. Le 22 août 1942, alors que Séféris vit au Caire, l’ambassade d’Angleterre téléphone: «Venez cet après-midi à six heures; to meet a distinguished person. » Après portails et portillons, le jardin intérieur, voilà la salle de bal : « Assis devant une table minuscule, tassé sur lui-même comme le Penseur de Rodin, à l’exception de la tête qui suivait du regard tout ce qui se passait alentour, Churchill. Il était vêtu d’une combinaison de couleur violette […] À la fin, à l’heure des questions, un journaliste coiffé d’un fez lui a demandé ce qu’il pensait de Rommel : les généraux sont comme ça, a-t-il répondu, parfois ils avancent, d’autres fois ils reculent, personne ne sait pourquoi... »
Plus observateur qu’homme d’action, Georges Séféris, en avril 1941, sur le point de suivre le gouvernement en partance pour la Crète, avait été bouleversé par une rencontre sur le débarcadère. Un jeune homme inconnu l’avait interpellé: « - Monsieur Séféris, qu’allons nous faire, nous qui restons ? » Et d’ajouter quand le poète lui répond que la guerre n’est pas perdue, qu’elle continue: « Je sais […] Là-haut sur la colline, j’ai caché une machine à écrire et du papier, pour les tracts. » « C’est la première fois, commente alors l’écrivain, depuis que j’ai pris la décision de partir, que je me sens mal à l’aise.» En 1967, quand la dictature des colonels se mettra en place, l’éternel exilé Séféris choisira de rester malgré tout. Il s’exposera, par une déclaration publique retentissante contre le régime. Et en 1971, ses obsèques à Athènes, suivies par une foule immense, apparaîtront comme une véritable manifestation d’opposition.
Par Frédérique Fanchette