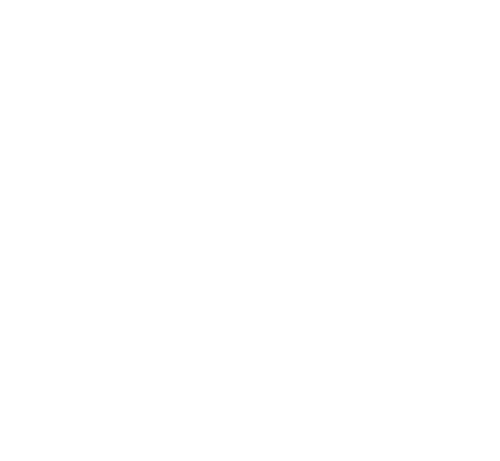Revue des Deux Mondes - Les lumières et le goulag

Les lumières et le goulag
Le 25 novembre 1950, les juges de la 17e chambre correctionnelle de Paris eurent à juger d’une plainte en diffamation dont la nature expliquait pourquoi la foule se pressait aux portes de leur tribunal. David Rousset, ancien résistant et déporté, fondateur quelques mois plus tôt d’une Commission internationale contre le régime concentrationnaire, y poursuivait Pierre Daix qui, dans un article des Lettres françaises, l’avait traité de « falsificateur trotskyste », contestant ainsi l’authenticité des témoignages sur lesquels Rousset fondait sa dénonciation des camps de travail soviétiques. Deux ans après, on rejouait, à guichets fermés, le procès Kravtchenko.
Échaudée, la défense des Lettres françaises, qui voulait surtout éviter que les audiences ne mettent en avant les témoignages d’anciens déportés du goulag, affirma que les débats ne devaient rouler que sur cette épithète de « falsificateur trotskyste », qui ne contestait pas forcément l’existence des camps mais laissait seulement entendre que Rousset avait manipulé certains textes.
Les rescapés des camps, dont Margarete Buber-Neumann, furent ainsi à chaque fois interrompus par des avocats qui s’exclamaient que de tels témoignages n’avaient rien à faire dans ce procès.
Cette stratégie d’intimidation et de désordre mutila ou coupa court à ces récits, les enveloppant à chaque fois d’un nuage d’encre juridique. Les débats ayant pris du retard, le dernier témoin cité par Rousset ne put comparaître et son audition fut reportée au lendemain. Le jour suivant, ce dernier témoin parut. C’était un homme grand, aux cheveux prématurément blanchis, aux épaisses lunettes rondes. Il s’exprima en russe d’une voix forte et pleine d’assurance. Précisant tout de suite qu’il parlerait de lui-même le moins possible, il affirma que puisqu’il était l’une des sources principales de Rousset, l’accusation de faux le concernait également.
« Mais si ce que j’ai écrit est la vérité, alors vous n’avez pas d’autre choix que de reconnaître que cet homme (montrant Pierre Daix) est un diffamateur et un calomniateur… Ni M. Rousset ni moi n’avons inventé les camps. C’est dans les camps que mes cheveux ont blanchi. Quelqu’un peut-il affirmer que M. Rousset a inventé mes cheveux blancs… Je peux reprendre à mon compte les paroles d’un grand poète polonais : “Je m’appelle Million, car j’aime et je souffre pour des millions d’hommes.” Pour les dizaines de milliers qui ont survécu aux camps de Staline et se trouvent aujourd’hui en Europe, l’honnêteté et la véracité des propos de Rousset ne font aucun doute. Reste à savoir ce qui a motivé la diffamation de M. Daix : est-ce la mauvaise foi ou bien l’infinie légèreté et ignorance de la jeunesse ? »
À ces mots, Pierre Daix s’étrangle et la foule ne peut retenir une sorte de cri. Chacun comprend que le procès vient de se jouer. Joë Nordmann, un des défenseurs communistes, aperçoit avec curiosité et inquiétude un livre qui circule de main en main dans le tribunal. Ce livre a pour titre La Condition inhumaine, et son auteur, l’homme dont la parole vient de faire frissonner la salle et de pulvériser la défense, est Julius Margolin.
Ce livre extraordinaire, tombé dans l’oubli pendant plus d’un demi-siècle, reparaît aujourd’hui dans une version enfin complète (1). Il s’agit de l’un des plus bouleversants témoignages sur la vie au goulag, que sa force et sa richesse mêmes ont sans doute desservi. C’est que bien des lecteurs ou des éditeurs cherchent dans ce genre d’ouvrage des sortes d’épopées négatives, aux arêtes pures et nues, où même la pire des atrocités resplendit de l’éclat du gel et de la neige. Mais rien n’est pur chez Margolin, ni la forme du récit ni le cœur des hommes. Il a connu plusieurs dimensions de l’enfer : celui des travaux d’abattage dans la forêt d’hiver, de la faim et de la déréliction, mais aussi et surtout l’arrière-boutique de ses emplois de bureau, la coulisse pathétique de ses hôpitaux, sa tragédie et sa comédie – si l’on ose prononcer ce mot – tant la comédie elle-même y prend quelque chose d’atroce, des figures de Dante peinturlurées par Gogol. Il a failli y mourir, rongé par le scorbut qui a fait tomber ses dents, mais la dimension burlesque qui affleure aussi dans ses souvenirs (sa première expérience de bûcheron est une scène à la Chaplin) a peut-être gêné, gâchant ce sentiment de purification par procuration que certains vont chercher dans les récits de la souffrance. L’œil impitoyable de Margolin, son ironie féroce ont peut-être aussi troublé, car elle n’épargne personne : aucun groupe humain, social ou ethnique, n’est idéalisé, aucun qui ne soit à un moment ou à un autre du récit mis en face de son style particulier de lâcheté ou de mensonge. Nulle misanthropie pourtant chez lui, ni même de pessimisme, seulement une lucidité qui trouve jusque dans ces vérités amères une confirmation de sa foi humaniste et universaliste.
Julius Margolin, né en 1900 dans une Pologne rattachée à l’Empire russe, avait, après avoir mené de brillantes études de philosophie à Berlin, émigré en Palestine, où il s’était installé avec sa femme et son fils en 1936. Revenu à Lodz pour revoir ses proches à l’été 1939, il se trouve pris au piège par le déclenchement de la guerre. C’est à ce moment que commence son livre, dont la première partie raconte une fuite éperdue dans l’écroulement de la Pologne, par les villes incendiées et les champs éclatant de lumière, comme si tout autour de lui s’effondrait un décor trompeur et surgissait la vérité : l’impéritie des autorités, l’égoïsme fondamental, la cruauté, la haine antisémite générale. Cette expérience initiale, très bien racontée, est une manière d’ouverture, resplendissant de cet étrange allegro des débâcles, une prémonition de ce qui l’attend : l’atroce, la cruauté font surgir un monde irréel mais où les mensonges ordinaires qui tenaient la société percent soudain, dérisoires et mornes comme le carton-pâte des villes-potemkine soviétiques. Refoulé de la frontière roumaine en tant que juif, transi par l’orage, perdu dans la nuit, le voilà sauvé le lendemain matin, croit-il, par l’entrée en Pologne de l’Armée rouge. Il passe alors plusieurs mois à tenter d’obtenir l’autorisation de retourner en Palestine avant d’être arrêté au printemps 1940, saisi dans une vague de déportation qui – nous apprend Luba Jurgenson dans sa postface – emporte plus de 200 000 personnes, essentiellement des « Occidentaux », c’est-à-dire des juifs polonais originaires des zones nouvellement annexées. Le lecteur découvrira toutes les vicissitudes des cinq années d’épreuves que va traverser Margolin, de plus en plus seul et affaibli, condamné à un effacement progressif. On notera seulement que son parcours semble suivre le cheminement sinueux et trompeur d’une spirale à la Eischer : quand il trouve un peu de répit à l’hôpital, ou dans un emploi de bureau, c’est pour se retrouver à sa sortie exclu d’une amnistie et transféré toujours un peu plus loin vers le nord. En 1944, alors que la plupart des « Occidentaux » sont morts ou libérés, on s’apprête à l’expédier à Vorkouta, l’enfer des mines du Grand Nord, le dernier cercle du goulag, le plus terrible, un camp dont il sait qu’il ne sortira pas vivant. On laisse le lecteur découvrir comment il échappera à ce destin funeste, et ce qu’il adviendra des trois manuscrits qu’il a rédigés en secret pendant sa captivité et qui l’ont sans doute aidé à survivre.
Car Margolin a écrit au goulag, s’est tout de suite posé en observateur du monde qui l’entourait, pressentant que c’était là le seul moyen de donner un sens à ce qu’il était en train de vivre. Et comme il est un héritier des Lumières, plein de cette curiosité encyclopédique qui se confond en lui au désir même de vivre, ses écrits constituent une sorte d’encyclopédie personnelle du monde concentrationnaire, pleine de considérations philosophiques, psychologiques, historiques, sociales, politiques, pratiques même car son esprit de pionnier le pousse à s’intéresser à l’organisation de cette colonie noire qu’est le goulag.
Or, et c’est peut-être là le cœur, le secret de la force de ce livre, ses réflexions sont fascinantes non pas tant par leur contenu – encore qu’elles soient souvent très intéressantes –, que par leur bigarrure, leur jaillissement, la force drue et inépuisable d’un esprit dont le mouvement même semble créer de la chaleur et de la vie. Il y a du Diderot chez Margolin, cet homme chez qui la demi-famine perpétuelle dont souffrent tous les prisonniers ne semble jamais avoir entamé un appétit presque féroce de l’esprit à tout regarder, tout comprendre, une curiosité goulue qui trouve partout motif à méditation, à découverte, même dans un tabassage nocturne dans un cachot nocturne et glacé où une bande de voyous lui écrasent la figure à coups de pied dans une mare d’excréments.
On trouvera ainsi entre autres dans le livre une analyse du processus de déshumanisation à l’œuvre dans les camps. Tout repose sur une idée simple, une excroissance monstrueuse d’un principe de morale prolétarienne : on ne mange qu’en proportion de son travail. Et au goulag les prisonniers ne mangent qu’en proportion du pourcentage qu’ils ont réussi à produire d’une norme imposée. L’individu se trouve dans un tel système réduit à sa pure force de travail manuel. Toutes les autres distinctions deviennent dérisoires parce qu’inutiles. Mais ce système est non seulement atroce, il est aussi mensonger. L’ignominie du camp, Margolin est très sensible à cette alliance, repose sur cette alliance de la cruauté et du mensonge. Car les résultats de production sont sans cesse truqués puisque, pour tenir, le système a besoin de faire croire qu’il est possible de remplir ou de dépasser la norme. Les travailleurs modèles stakhanovistes sont en réalité favorisés. Et les autres, pour survivre, sont condamnés à toujours chercher à mentir, à truquer. Au camp, la seule liberté laissée à l’esprit, à l’intelligence, est celle du mensonge.
Une autre analyse originale de Margolin concerne la comparaison des camps de travail nazis et soviétiques. Pour lui, le système concentrationnaire nazi est un « cancer » de l’Europe, une excroissance maligne de sa civilisation qu’on pourra amputer. Le système soviétique est une parodie. Il s’inscrit dans une tradition historique où l’imitation, apparemment utilitariste, d’un modèle occidental recouvre en réalité une critique, un défi lancé à l’Occident. Ce sont les nazis qui croient à ce qu’ils font. Consciemment ou inconsciemment, les bolcheviques n’y voient qu’une farce, le ricanement provocateur qu’ils adressent aux valeurs d’individualisme et de liberté de l’Occident.
Dantesque, pourquoi cet adjectif banal semble-t-il si juste aux lecteurs, et aux auteurs eux-mêmes de ces témoignages ? C’est que dans ce monde de la déshumanisation, les plus infimes particularités des individus, pourtant défaits, mais peut-être justement parce que défaits, acquièrent un relief extraordinaire. À peine posés sur la page, les personnages de Margolin existent avec la force et l’évidence des damnés de Dante parce que la réduction atroce dont ils ont été les victimes leur donne quelque chose de sculptural et de mythique : Peterfreund le nain, Vassia l’enfant tuberculeux, Met le provocateur simple d’esprit, Vania l’enfant de déportés qui n’a connu que les camps, Ivan V qui plonge dans la folie, autant de caractères inoubliables par cette grandeur ambiguë que leur a conféré la mutilation de leur être. De même, les situations que vivent ces hommes, toujours liées à la dimension extrême et fondamentale de la mort et de la survie, sont en même temps infiniment variées dans leur circonstance, leur ironie terrible, les dilemmes de leurs pièges, et l’imagination dans la cruauté dont elles témoignent leur confère quelque chose de fantastique. Pourquoi se voiler la face ? Les lecteurs de ce genre de livres ne les lisent pas seulement par curiosité historique ou devoir moral. Souvent ils y trouvent la grandeur et la force qu’ils iraient chercher dans des fables s’ils pouvaient les y trouver.
Car le livre de Julius Margolin est aussi et surtout un extraordinaire récit. Il est d’ailleurs fascinant de constater à quel point cet intellectuel si soucieux de tout comprendre et de tout analyser peut changer de registre ou d’affect sans que pourtant ne changent le timbre et l’inflexion de sa voix. Ses pages prennent alors l’accent de l’autobiographie intime, comme dans ces passages où le souvenir d’un compagnon de captivité, Tchikavani le Géorgien, est évoqué avec une tendresse, une chaleur royales, et où l’humanité est indissociable de la noblesse du ton qui l’exprime. Souvent aussi, et toujours aussi naturellement, sa voix devient celle d’un pur conteur, dont le sens du détail, de la caractérisation, la lucidité et l’absence de sentiments rappellent le Tchekhov de la Salle n°6.
C’est que la plongée dans l’univers des camps, avant d’aboutir à l’engourdissement de la conscience et à la perte de la mémoire, correspond d’abord à une expérience de que les Russes appellent l’ostraniénié, cette destruction de l’automatisme de la perception d’où surgit la réalité des choses et des êtres et qui constitue, selon Chlovski, l’essence de l’art littéraire, le secret de la force expressive de Tolstoï ou de Tchekov. Imprégné de cette culture littéraire russe, Margolin fut peut-être grâce à elle mieux à même de saisir comment ce qu’il était en train de vivre pourrait un jour prendre forme dans un texte, que cette expérience de l’étrangeté pouvait être source de richesse, prendre une dimension spirituelle s’il arrivait un jour à la traduire dans des mots.
Il faut imaginer Julius Margolin, revenu en Palestine, penché sur son manuscrit pendant ces dix mois de décembre 1946 à octobre 1947 durant lesquels il rédige les 700 pages de son livre. La mémoire lui revient, des hommes, des lieux, des odeurs, des cathédrales intellectuelles qu’il bâtit pour survivre sur son grabat, et dans le courant du texte qui l’emporte, nul doute qu’il ne sente comme nous ce qui fait la beauté de son texte, cette force vitale qui naît dans les mots, par les mots, transforme son expérience en une matière vivante, et que cette transmutation représente mieux qu’un témoignage, une réponse.
La force et la grandeur des témoignages sur les camps de travail nazis ou soviétiques n’obscurcit-elle pas de son éclat le destin de ces millions d’êtres qui n’ont jamais pu témoigner : les 14 millions de victimes des massacres de masse perpétrés entre 1933 et 1953 sur ces « terres sanglantes » comme les nomme Timothy Snyder, historien à Princeton, qui vient de leur consacrer un ouvrage Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin (2). S’il n’apporte rien de véritablement nouveau, le livre présente l’originalité d’analyser ce phénomène d’extermination comme un phénomène global, qui possède une unité sociale, historique, presque anthropologique, et sans que cette réflexion soit offusquée par les débats sans fin d’évaluation morale comparative des intentions qui présidèrent au crime. Les « terres de sang » sont ces terres de marche, bigarrures de peuples, aux souverainetés politiques fluctuantes, qui s’étendent de Poznan à Smolensk et où en vingt ans 14 millions de personnes ont été massacrées dans des camps d’extermination, par des exécutions sommaires ou dans des entreprises de famine planifiée, par deux régimes totalitaires qui mirent en place et assumèrent juridiquement, politiquement, logistiquement, deux entreprises de meurtres de masse. Tout le monde croit savoir ces choses, mais qui les comprend ? Qui comprend que ces chiffres signifient, pour joindre le goût ancien de l’allégorie à la manie moderne des moyennes, que pendant vingt ans l’Europe a, chaque année, égorgé 700 000 de ses enfants ?
Pour Timothy Snyder, deux grandes raisons expliquent ce phénomène. La première, c’est que cet espace géographique constituait le champ d’application de deux utopies volontaristes : pour Staline, sa transformation en un espace agricole parfaitement collectivisé, c’est-à-dire socialement homogène, c’est-à-dire souvent ethniquement homogène puisque – et c’est un des grands mérites du livre de Snyder de le mettre en évidence – toute différence identitaire est un obstacle virtuel à l’homogénéisation sociale. Dans un autre ouvrage paru récemment, Stalin’s Genocides, Norman M. Naimark fait lui aussi remarquer que les meurtres de masse perpétrés par le régime soviétique obéirent souvent à des motivations ambiguës où le « racial », le « religieux », le « social » ne se distinguent guère (3). Voilà pourquoi dans ces marches occidentales furent mises en place dès 1930 ces « opérations » de déportation ou d’extermination qu’évoque Luba Jurgenson dans sa postface (en 1930, l’opération anti-polonaise aboutit à l’exécution de 78 % des personnes arrêtées). Pour Hitler, ces mêmes territoires devaient être transformés un espace colonial agricole réservé aux Allemands et donc destiné au « nettoyage ethnique », à l’extermination des juifs par des exécutions sommaires et de la population paysanne ukrainienne par la confiscation des grains.
La seconde raison qui explique l’ampleur du phénomène tient à ce que, les deux régimes venant à s’affronter au cœur même de cet espace, les logiques criminelles inhérentes à leurs projets prirent un tour exponentiel. Le conflit ajouta d’abord un autre motif au crime de masse : le traitement des prisonniers de guerre. Les Allemands ont volontairement fait mourir de faim 3 millions de prisonniers soviétiques, les Soviétiques 500 000 prisonniers allemands avant de juger préférable de les utiliser comme main-d’œuvre forcée : selon Timothy Snyder, près de 4 millions de prisonniers de guerre, toutes nationalités confondues, ont été ainsi envoyés au Goulag. Mais l’autre aspect de cette intensification, plus atroce peut-être encore parce que plus mystérieux, réside dans les logiques d’imitation que la guerre semble déclencher : Allemands et Soviétiques, pour les mêmes raisons, éliminent les élites polonaises. Ici encore cette mutualisation de la haine s’explique-t-elle en partie par le projet criminel d’homogénéisation sociale. Mais c’est pour les juifs que cette logique apparaît dans toute sa violence aveugle : les Baltes, pour se venger des purges soviétiques, s’en prennent aux juifs, et, plus mystérieusement encore puisque la souffrance au lieu de faire naître la pitié semble exciter la haine, les massacres de juifs par les Allemands exacerbent l’antisémitisme russe, la découverte des camps de la mort poussera Staline à envisager une persécution antisémite systématique.
Cet étrange et monstrueux mimétisme du crime, Margolin en fut le témoin au camp, dès que la guerre éclata entre l’URSS et l’Allemagne. Car la planification, l’organisation bureaucratique, le régime des quotas, qui organisèrent ces deux grands processus d’extermination, ne doivent pas dissimuler que c’est bien la haine – une pulsion profonde à laquelle l’idéologie ne fournit qu’on oripeau de rationalité – qui présida à leur naissance et s’enivra de leur perpétration. Cette haine paranoïaque qu’aucune morale ne peut combattre puisque les meurtriers qu’elle suscite ne pensent pas faire le mal, mais lutter pour leur survie, même lorsqu’ils écrasent le crâne d’un enfant. Julius Margolin lui a consacré un des ouvrages qu’il composa au goulag, intitulé justement De la doctrine de la haine. Il en analyse la logique, qui repose sur le besoin de de trouver un coupable à sa souffrance et de le faire souffrir pour la faire disparaître : « Mais comme le lien établi entre son propre malheur et la faute d’autrui est imaginaire, les actes découlant de la haine ne l’éteignent pas… Les crimes commis sont inutiles et n’apportent pas de satisfaction, ils sont sans fin car la haine est un cercle vicieux. »
Frédéric Verger
1. Julius Margolin, Voyage au pays des Ze-Ka, traduit du russe par Luba Jurgenson, Nina Berberova, Mina Journot, Le Bruit du temps, 2010.
2. Timothy Snyder, Bloodlands : Europe Between Hiltler and Staline, The Bodley Head Ltd, 2010.
3. Norman M. Naimark, Stalin’s Genocides, Princeton University Press, 2010.